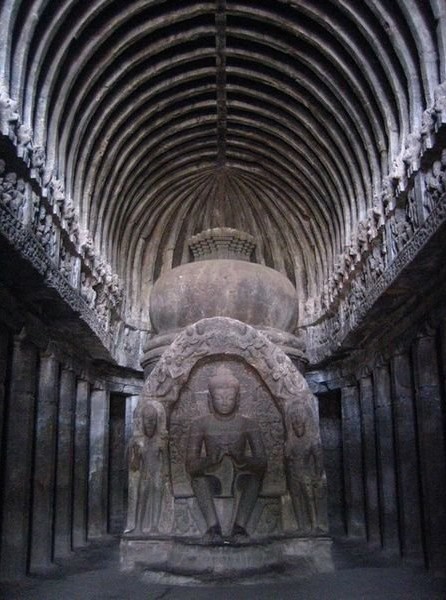A gauche, quatre palmiers qui furent peut-être six. Un tronc mort. A droite un bananier. En face, et tout en bas, la baie très bleue. Le port d'Alger. L'empilement des conteneurs sous les portiques. Le fouillis des grues et des flèches, les rails. Plus loin les cargos sur coffres. On aimerait reposer là. Davantage encore venir s'y recueillir sur le souvenir d'un ami. Les terrasses sont bordées de balustrades blanches à croisillons, entortillées de clématites pourpres. Les concessions à l'abandon envahies de sumacs aux feuilles très vertes et pointues. Manière de cimetière italien à flanc de coteau, tombes blanches. Des bancs pour voir la mer et penser aux défunts. Gênes en moins pompeux. Le voisin de Brazza est le biologiste Emile Maupas. Puisqu'on déporte la famille, pourquoi pas les voisins ?
Patrick Deville, Equatoria
Seuil, 2009